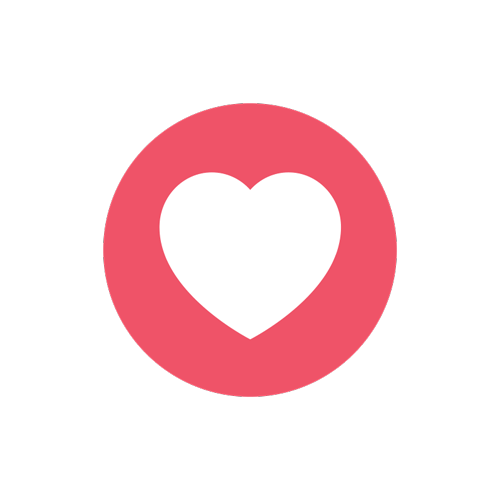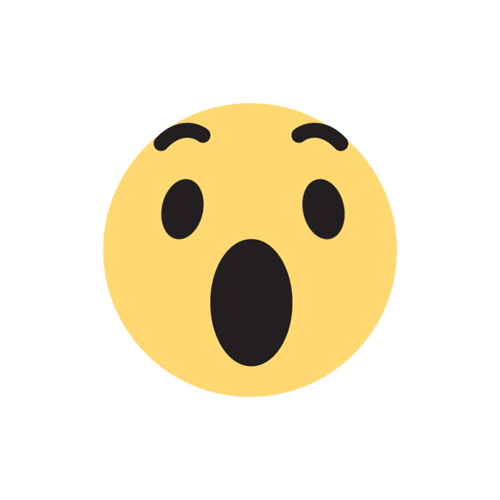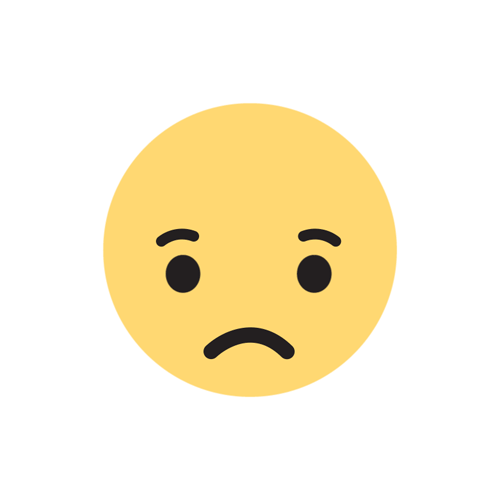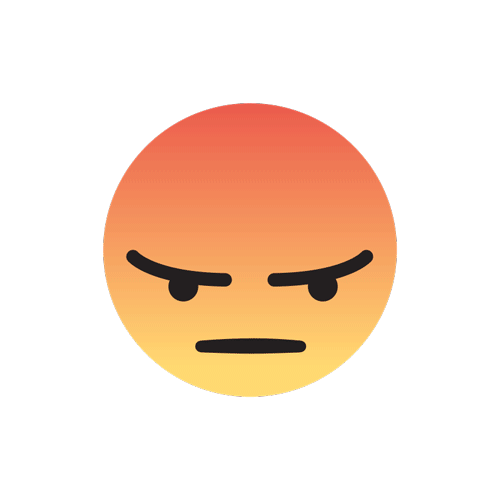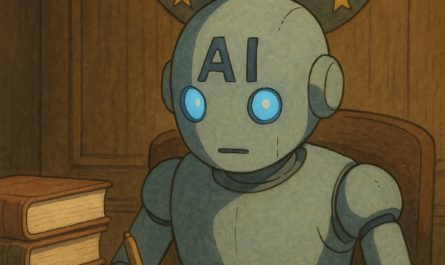**Devoir maison – Propriété intellectuelle et numérique**
**Sujet :**
Vous devez choisir **une affaire récente** (jugée en France ou à l’étranger) portant sur une question de **propriété intellectuelle** (droit d’auteur, marques, brevets, dessins & modèles, etc.) **en lien avec le numérique** (plateformes, IA, réseaux sociaux, NFT, métavers, jeux vidéo, streaming, etc.).
**Consignes :**
1. **Citer clairement votre source** (décision de justice, article doctrinal, article de presse spécialisé, blog juridique, etc.).
2. **Présenter les faits et la problématique juridique** de manière claire et concise.
3. **Analyser juridiquement** la solution donnée par la juridiction (ou, si l’affaire est en cours, la problématique soulevée).
4. **Donner votre propre solution juridique motivée** en une page maximum (Times New Roman, 12, interligne 1,5).
**Objectif :**
Vérifier votre capacité à :
* trouver une source fiable,
* comprendre une affaire en matière de propriété intellectuelle et numérique,
* résumer et expliquer l’enjeu juridique,
* proposer une analyse personnelle argumentée.
**Date limite de rendu :** \[12/09/2025].
La protection de la propriété intellectuelle (PI) est un domaine dynamique, marqué par une interaction constante entre les cadres juridiques nationaux, régionaux et internationaux. L’essor du numérique et de l’intelligence artificielle (IA) a introduit de nouvelles complexités et a nécessité des adaptations dans la manière dont les droits sont définis, protégés et appliqués.
Voici un aperçu des approches et spécificités de la protection de la PI dans différents pays et régions, en se concentrant sur les marques, le droit d’auteur et les défis posés par l’IA :
- Les Cadres Internationaux et Régionaux pour les Marques : Une Volonté d’Harmonisation
Les systèmes internationaux visent à simplifier le processus d’enregistrement et à harmoniser les pratiques.
- La Classification de Nice (OMPI) est un système international de classement utilisé pour les produits et services aux fins de l’enregistrement des marques. Elle est composée de 45 classes, dont 34 concernent les produits et 11 les services. Les pays parties à l’Arrangement de Nice sont tenus de l’appliquer, et de nombreux pays non-parties l’utilisent également. Son principal avantage est de simplifier la rédaction des demandes et de garantir que les produits et services soient classés de la même manière dans tous les pays l’ayant adoptée.
- Le Système de Madrid (OMPI) offre une solution pratique et économique pour l’enregistrement et la gestion des marques dans 131 pays. Il permet de déposer une seule demande d’enregistrement international et de payer une seule série de taxes pour demander une protection dans plusieurs pays, à condition d’avoir déjà une marque nationale ou régionale. Cependant, il est important de noter que la classification des produits et services ne lie pas les pays contractants quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque.
- Dans l’Union Européenne, le règlement (UE) 2017/1001 harmonise les dispositions relatives aux marques au sein des États membres. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) joue un rôle central dans l’harmonisation du droit, y compris pour les marques et les exceptions au droit d’auteur.
- Le Droit d’Auteur : Des Approches Variées pour les Exceptions
La manière dont les exceptions au droit d’auteur sont formulées et interprétées diffère significativement d’une juridiction à l’autre.
- Aux États-Unis, l’exception de “Fair Use” est caractérisée par une approche ouverte, où la liste des fins autorisées (critique, commentaire, enseignement) est non-exhaustive (“telles que”). L’évaluation repose sur quatre critères, également non-exhaustifs, et accorde une importance particulière au caractère “transformatif” de l’utilisation de l’œuvre. Cette approche est ancrée dans l’idée constitutionnelle de “promouvoir le progrès de la science et des arts utiles”.
- Au Canada, l'”Utilisation Équitable” suit une approche plus limitée ou semi-ouverte. Les contextes d’application sont clairement identifiés par la loi (étude privée, recherche, éducation, parodie, satire), formant une liste fermée. Contrairement au droit américain, la loi canadienne ne fournit pas de critères d’évaluation statutaires pour ces exceptions. La Cour Suprême du Canada, cependant, a adopté une interprétation large des exceptions, cherchant un “juste équilibre” entre les droits des créateurs et l’intérêt public, même si cela n’implique pas toujours une “transformation” de l’œuvre.
- Dans l’Union Européenne, la CJUE s’efforce d’harmoniser les exceptions au droit d’auteur en les qualifiant de “notions autonomes” du droit de l’Union. Cela signifie qu’elles doivent être interprétées uniformément dans tous les États membres. Les pays membres peuvent limiter le périmètre de ces exceptions facultatives, mais pas en remettre en cause la notion même. Par exemple, en France, la loi limite la copie privée à l’usage personnel du copiste et les exceptions à des fins de recherche et d’enseignement aux “extraits d’œuvres”.
- L’Intelligence Artificielle et la Propriété Intellectuelle : Un Défi Mondial Émergent
L’IA soulève des questions fondamentales sur la titularité, la brevetabilité et la protection des créations.
- Question de la Titularité : L’IA brouille les pistes quant à la propriété des œuvres qu’elle génère, car l’apport humain se dilue dans le processus d’apprentissage. En France, les droits de PI ne sont reconnus qu’aux personnes physiques ou morales, excluant de fait l’IA en tant que titulaire. L’IA Act européen et la Convention-cadre sur l’IA du Conseil de l’Europe se concentrent sur la sécurité des utilisateurs et les droits fondamentaux, mais n’abordent pas directement la question de la propriété intellectuelle des créations de l’IA. Il est donc crucial pour les utilisateurs d’IA de lire les conditions d’utilisation et de conserver les preuves de leur apport créatif humain.
- Brevets et Inventeurs : La plupart des législations en matière de brevets exigent un inventeur humain. Les affaires entourant l’IA DABUS ont montré que de nombreux offices de PI (Royaume-Uni, Office européen des brevets, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Allemagne) ont rejeté l’IA comme inventeur, insistant sur la nécessité d’une contribution humaine. L’Afrique du Sud a toutefois délivré un brevet à DABUS sans examen au fond. L’Allemagne a suggéré de mentionner l’IA comme co-inventeur aux côtés d’un humain. L’OMPI explore diverses options pour l’avenir, allant du maintien du statu quo à la création d’un droit sui generis spécifique pour les inventions générées par l’IA, qui pourrait inclure des règles adaptées pour la titularité, l’évaluation de l’inventivité et des durées de protection différentes.
- Droit d’Auteur et IA Générative : En Europe, la directive (UE) n° 2019/790 prévoit une exception de fouille de textes et de données (TDM) pour l’entraînement des IA, sous conditions d’accès licite et de possibilité pour l’auteur de s’y opposer (opt-out). Cependant, l’utilisation de bases de données illicites est une source de contentieux. L’IA Act impose une obligation de transparence sur les contenus utilisés pour entraîner les modèles d’IA à usage général. Aux États-Unis, plusieurs actions judiciaires sont en cours contre les fournisseurs d’IA, testant les limites du “fair use” pour l’utilisation non autorisée de contenus protégés.
- La Lutte Contre la Contrefaçon en Ligne et la Responsabilité des Plateformes
L’ère numérique a multiplié les défis en matière de contrefaçon, plaçant les plateformes au cœur des mécanismes de lutte.
- En France et dans l’Union Européenne, la lutte contre la contrefaçon de marques et de droits d’auteur est encadrée par le Code de la propriété intellectuelle et les règlements européens. La directive e-commerce exempte les hébergeurs de responsabilité s’ils ne sont pas informés du caractère illicite des contenus et agissent promptement pour les retirer. Le Digital Services Act (DSA) renforce les obligations des plateformes. La Cour de cassation française a précisé que les titulaires de droits n’ont pas à prouver la titularité ou l’originalité des contenus au stade de la notification de leur caractère manifestement illicite. Si une obligation générale de surveillance est prohibée, une surveillance ciblée et temporaire est autorisée. La directive (UE) n° 2019/790 impose aux services de partage de contenus en ligne un régime de “take down, stay down”, les obligeant à empêcher la réapparition des contenus illicites signalés.
- Les grandes plateformes de e-commerce (Amazon, eBay, Alibaba) utilisent l’intelligence artificielle et le machine learning pour détecter les contrefaçons et proposent des programmes de protection spécifiques aux marques (Brand Registry, VeRO).
- Le Métavers présente des défis uniques en raison de son absence de frontières, rendant la protection de la PI plus complexe. Les politiques internes des plateformes (Roblox, Decentraland) jouent un rôle crucial pour limiter les atteintes. La collecte massive de données dans le métavers soulève également d’importantes questions juridiques et éthiques.
- L’Enregistrement des Marques : Les Spécificités Nationales
Même avec des systèmes internationaux, les spécificités nationales restent importantes, notamment en matière de diligence.
- En France (INPI), le choix des classes lors du dépôt de marque est fondamental car il détermine l’étendue de la protection. Une marque n’est protégée que pour les produits et services spécifiquement désignés. Il est possible que deux marques identiques coexistent si elles sont déposées dans des classes différentes et qu’il n’y a pas de risque de confusion pour le consommateur. L’INPI ne vérifie pas la disponibilité du signe ; c’est la responsabilité du déposant de mener des recherches d’antériorités approfondies. Le coût de base est de 190€ pour une classe, avec 40€ par classe additionnelle, pour une protection de 10 ans renouvelable. Il n’est pas possible d’ajouter de nouvelles classes après un dépôt initial ; un nouveau dépôt est nécessaire dans ce cas.
En conclusion, la protection de la PI est un champ en constante évolution, où les approches traditionnelles sont remises en question et adaptées pour répondre aux réalités du monde numérique et de l’intelligence artificielle. Les systèmes internationaux apportent une ossature, mais les spécificités nationales et régionales, ainsi que la jurisprudence, restent essentielles pour comprendre l’étendue réelle de cette protection.
La jurisprudence relative aux jeux vidéo est un domaine complexe et en constante évolution, principalement en raison de la nature hybride de ces œuvres et des défis posés par les nouvelles technologies, notamment les plateformes en ligne et l’intelligence artificielle.
Voici les points clés de la jurisprudence concernant les jeux vidéo :
• Qualification juridique du jeu vidéo : une “complexité” persistante
◦ Historiquement, le jeu vidéo a été qualifié de manière unitaire sur le fondement du droit spécial propre au logiciel.
◦ Cependant, la jurisprudence française, notamment avec l’arrêt Cryo de la Cour de cassation du 25 juin 2009, a fait évoluer cette qualification vers une approche distributive. Cela signifie que différentes dimensions du jeu peuvent relever de règles distinctes :
▪ Le droit spécial du logiciel (Directive n° 2009/24/CE) pour la partie logicielle.
▪ Le droit commun du droit d’auteur (Directive 2001/29/CE) pour des éléments comme le scénario et les effets audiovisuels.
▪ Éventuellement, le droit des bases de données.
◦ Cette complexité rend parfois ardue l’identification précise des atteintes aux droits pour les titulaires.
◦ Une réflexion législative sur le jeu vidéo serait nécessaire pour apporter plus de clarté.
• Logiciels de triche et contrefaçon logicielle
◦ La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans son arrêt du 17 octobre 2024, affaire C-159/23 (Sony c/ Datel), a statué sur la question de savoir si un logiciel de triche modifiant les “variables” d’un jeu dans la mémoire vive d’un ordinateur constitue une contrefaçon.
◦ La CJUE a conclu que le logiciel de triche n’est pas contrefaisant au regard de la directive n° 2009/24/CE (protection des programmes d’ordinateur).
◦ La Cour a distingué les paramètres des variables (qui relèvent de l’expression littérale du programme et sont protégeables) de la valeur ou du contenu de ces variables (qui ne sont pas protégeables par le droit spécial du logiciel, car ils ne permettent pas la reproduction ou la réalisation ultérieure du programme). Le logiciel de triche modifie la valeur des variables sans altérer le code source ou objet du programme.
◦ Cette décision souligne que fonder une action uniquement sur la contrefaçon logicielle peut être une erreur stratégique, car l’atteinte au jeu lui-même (par exemple, au scénario ou à l’intégrité de l’œuvre) aurait pu être invoquée sur le fondement du droit commun du droit d’auteur.
• Responsabilité des hébergeurs et lutte contre les copies illicites
◦ Les sociétés titulaires de droits, comme Nintendo, sont très vigilantes face au piratage de leurs jeux.
◦ La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2025, n° 23-15.966 (Nintendo), a clarifié la distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en responsabilité de l’hébergeur.
◦ Lorsqu’une action est fondée sur la responsabilité de l’hébergeur (conformément à la Directive e-commerce 2000/31/CE et sa transposition française, la LCEN), les titulaires de droits n’ont pas à prouver en détail la titularité des droits ou l’originalité des œuvres au stade de la notification. Il suffit que la notification décrive les faits permettant à l’hébergeur de connaître le caractère manifestement illicite du contenu.
◦ Une mesure ordonnant le retrait ou le blocage d’accès à des copies illicites sous astreinte, pour une durée limitée (par exemple, six mois), est considérée comme une activité de surveillance ciblée et temporaire, et non comme une obligation générale de surveillance prohibée par la loi.
La jurisprudence concernant le déverrouillement et l’accès aux données des téléphones portables par les autorités, notamment la police, a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Cet ensemble de décisions établit un équilibre délicat entre la protection des données à caractère personnel et l’efficacité des enquêtes pénales.
Voici les points clés de cette jurisprudence, notamment l’arrêt C. G. de la CJUE du 4 octobre 2024 (aff. C-548/21) :
• Champ d’application de la protection
◦ La directive (UE) n° 2016/680 (dite « police-justice ») est le texte de référence.
◦ La notion de « traitement de données » est interprétée de manière large et inclut la saisie et la manipulation d’un téléphone portable, même si la tentative d’accéder à son contenu est infructueuse. Cela vise à garantir un niveau élevé de protection des données et à éviter l’insécurité juridique.
• Contrôle préalable par une autorité indépendante
◦ L’accès aux données contenues dans un téléphone portable à des fins d’enquêtes pénales en général doit être soumis à un contrôle préalable effectué par un juge ou une entité administrative indépendante.
◦ Cette exigence découle de l’article 4, paragraphe 1, sous c) de la directive (UE) 2016/680, lu à la lumière des articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
◦ L’autorité de contrôle doit être habilitée à refuser ou à restreindre l’accès si l’ingérence est disproportionnée, en tenant compte de la gravité de l’infraction et des besoins de l’enquête.
◦ En cas d’urgence dûment justifiée, le contrôle peut être postérieur, mais il doit intervenir à bref délai.
• Exigences de nécessité et de proportionnalité
◦ L’accès aux données doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité.
◦ L’exigence de nécessité implique de choisir le moyen le moins attentatoire aux droits fondamentaux, à efficacité égale.
◦ Le caractère proportionné est évalué au cas par cas, en considérant :
▪ La gravité de l’ingérence (qui est jugée grave, voire particulièrement grave, car les données peuvent révéler des aspects très précis de la vie privée et inclure des données sensibles).
▪ La nature et la sensibilité des données.
▪ L’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi.
▪ Le lien entre le propriétaire du téléphone et l’infraction pénale.
▪ La pertinence des données pour établir les faits.
• Portée de l’accès et criminalité grave
◦ Contrairement à sa jurisprudence antérieure (comme dans l’affaire Prokuratuur), la CJUE, dans l’affaire C. G., a refusé de limiter l’accès aux données d’un téléphone portable uniquement aux cas de criminalité grave. Cette position témoigne d’un certain “réalisme” de la Cour face à la fréquence de cet acte d’investigation.
◦ Cependant, une limitation personnelle demeure : l’accès nécessite des soupçons raisonnables, objectivement étayés et suffisants, contre le propriétaire du téléphone concernant son implication dans une infraction.
• Droit à l’information de la personne concernée
◦ Les autorités nationales doivent informer la personne concernée des tentatives d’accès à ses données, dès que cette information n’est pas susceptible de nuire à l’enquête.
◦ Cette information est cruciale pour permettre à la personne d’exercer son droit à un recours effectif, conformément aux articles 13, 14 et 54 de la directive (UE) 2016/680 et aux articles 47 et 52 de la Charte.
• Conséquences en droit interne français
◦ La décision C. G. aura des implications sur la régularité des saisies et exploitations de téléphones portables dans la procédure pénale française.
◦ Suite à une jurisprudence de la Cour de cassation du 27 février 2024, qui avait annulé des actes d’investigation contraires au droit de l’Union, les juridictions françaises devront déterminer le “grief” que les personnes concernées devront démontrer. Ce grief pourrait inclure l’absence de soupçons raisonnables, la violation du droit à l’information préalable, ou le caractère excessif de la saisie ou de l’exploitation du téléphone.
En somme, la CJUE a encadré strictement les conditions d’accès des forces de l’ordre aux données des téléphones portables, en insistant sur la nécessité d’un contrôle préalable et le respect de la proportionnalité, tout en assouplissant l’exigence de “criminalité grave” pour l’accès aux données, mais en maintenant celle de “soupçons raisonnables”
https://wayground.com/join?gc=665350&source=liveDashboard